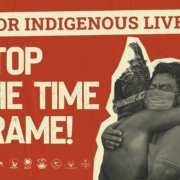Donateurs peinent à fournir les fonds climatiques aux Peuples Autochtones
L’Alliance des Peuples Autochtones et des communautés locales des forêts d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie publie un rapport à l’occasion de la COP28 suggérant que les donateurs peinent à fournir les fonds climatiques promis directement aux Peuples Autochtones et aux communautés locales.
Alors que les négociateurs de l’ONU débattent de la manière d’investir des milliers de milliards, les expériences et les preuves présentées à Dubaï suggèrent que les fonds acheminés par l’intermédiaire de tierces parties “s’évaporent” avant d’atteindre les communautés, qui se sont révélées excellentes dans la restauration des forêts et la prévention de la déforestation.
DUBAI — (3 décembre 2023) Lors de la Conférence de l’ONU sur le climat qui s’est tenue aujourd’hui, une alliance mondiale de Peuples Autochtones et de communautés locales de 24 pays forestiers tropicaux a publié un rapport identifiant des failles importantes dans les efforts mondiaux visant à financer les communautés qui conservent certaines des forêts tropicales les plus riches en biodiversité et en carbone du monde en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Selon l’étude publiée aujourd’hui par l’Alliance Globale ale des Collectivités Territoriales (GATC), les donateurs continuent d’utiliser des systèmes inadéquats et obsolètes pour documenter et fournir l’aide au développement, et envoient souvent l’argent destiné aux Peuples Autochtones et aux communautés locales par l’intermédiaire de tiers, ce qui limite les montants qui leur parviennent. Pour parvenir à leurs conclusions, les auteurs se sont appuyés sur des informations fournies par les Peuples Autochtones et les communautés locales, sur un examen des données des donateurs accessibles au public, sur une enquête menée auprès de partenaires et d’alliés, ainsi que sur les idées recueillies lors d’un atelier organisé à Paris pour discuter des obstacles et des solutions permettant de suivre les fonds et de rendre compte de l’impact de l’aide.
“Nous sommes déterminés à travailler avec les donateurs pour mettre en place un système qui nous convienne à tous”, a déclaré Mina Setra, une femme autochtone Dayak Pompakng de West Kalimantan, en Indonésie, et secrétaire générale adjointe de l’AMAN (Alliance des Peuples Autochtones de l’archipel), une organisation autochtone qui compte 2 565 communautés membres. “Nous pensons qu’en agissant de la sorte, nous pourrons augmenter nos contributions”.


Peuples autochtones d’Asie lors du lancement du Fonds Nusantara. Photo: TINTA
Présentées aujourd’hui lors d’un événement parallèle à la COP28, les conclusions du GATC sont publiées alors que les négociateurs des Nations unies sur le climat s’apprêtent à conclure un accord représentant des milliers de milliards de dollars pour la mise en œuvre et le financement de solutions “fondées sur la nature” et d’autres solutions pour faire face à la crise climatique. On estime que 36 % des forêts intactes restantes dans le monde, au moins 24 % du carbone aérien des forêts tropicales et jusqu’à 80 % de la biodiversité forestière restante dans le monde se trouvent sur les territoires des Peuples Autochtones. Pourtant, le premier bilan mondial de la CCNUCC s’est abstenu de demander des fonds pour soutenir les droits fonciers des Peuples Autochtones et des communautés locales, ainsi que le rôle considérable qu’ils ont joué dans la conservation et la restauration des forêts tropicales.
En détaillant leurs résultats, les auteurs du rapport du GATC ont conclu que seule une petite fraction du financement international pour la biodiversité, le changement climatique et le développement durable est allouée aux Peuples Autochtones et aux communautés locales. Lorsque les données sont disponibles, ils soulignent la discrimination omniprésente à laquelle sont confrontés les Peuples Autochtones et les communautés locales, mais aussi leur rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, ainsi que dans la réalisation d’un développement durable qui ne laisse personne de côté.

Les dirigeants des GATC affirment que les crises croisées du changement climatique, de la perte de biodiversité et de l’inégalité font qu’il leur est difficile de maintenir un mode de vie durable et de transmettre leurs connaissances traditionnelles, leurs pratiques et leurs innovations aux générations futures. Les données recueillies sur le terrain illustrent le peu d’argent qui parvient aux communautés. Une enquête menée auprès des membres du GATC montre que peu d’organisations locales de leurs réseaux fonctionnent avec des budgets supérieurs à 200 000 dollars, et que de nombreuses organisations locales ont un budget annuel inférieur à 10 000 dollars. Selon le rapport du GATC, on demande aux communautés de faire de grandes choses avec peu d’argent.
Le double défi du manque d’informations sur le manque de financement est repris dans un second rapport, publié vendredi par le Forest Tenure Funders Group (FTFG), qui comprend des pays donateurs et des organisations philanthropiques ayant pris l’engagement collectif, lors de la COP26 à Glasgow, de fournir un total de 1,7 milliard de dollars en cinq ans directement aux peuples indigènes et aux communautés locales.
Le Forest Tenure Funders Group a indiqué que les chiffres cités dans le rapport de l’année dernière surestimaient le montant des fonds versés directement aux communautés ; il s’agissait en fait de 2,9 %. Alors que le montant du financement destiné aux communautés a légèrement augmenté pour atteindre 8,1 millions de dollars en 2022, le pourcentage global des fonds directs a diminué pour atteindre 2,1 %, malgré l’engagement du groupe à augmenter le soutien direct.

“Les organisations philanthropiques et les gouvernements donateurs qui ont promis 1,7 milliard de dollars à Glasgow veulent vraiment que nous réussissions, mais le pourcentage que les communautés reçoivent dans le cadre de cette promesse est passé de 2,9 % la première année à 2,1 % la deuxième année”, a déclaré Levi Sucre Romero, un dirigeant bribri du Costa Rica qui siège au conseil du GATC et préside l’Alliance méso-américaine des peuples et des forêts (AMPB). “Cela signifie que nous reculons ; il devient de plus en plus évident qu’il est difficile pour les donateurs de nous confier l’argent dont nous avons besoin pour renforcer notre rôle de gardiens”.
Le président de la Fondation Ford, Darren Walker, qui a rédigé une introduction au rapport du Forest Tenure Funders Group, a reconnu le problème, notant que les pratiques et les priorités des donateurs “n’évoluent pas assez vite”.
“Pour dire les choses simplement, le financement reste insuffisant, inéquitable et inflexible”, a écrit le président de la Fondation Ford dans son introduction. “En 2022, un volume inacceptable de financement – seulement 8,1 millions de dollars – a été versé directement par les donateurs aux (Peuples Autochtones, communautés locales et descendants d’Africains). Je suis déçu par la lenteur de nos progrès sur ce point, et je sais que nos partenaires autochtones, communautés locales et descendants d’Africains le seront également.”
Des solutions indigènes pour corriger les systèmes défectueux de fourniture de l’aide
En novembre, le GATC a organisé un atelier de deux jours qui a attiré à Paris 65 représentants de réseaux de Peuples Autochtones, de communautés locales, de donateurs nationaux, de bailleurs de fonds philanthropiques, d’agences onusiennes et multilatérales, d’organisations de la société civile et de chercheurs. Tenu selon les règles de Chatham House, l’événement a contribué au rapport publié aujourd’hui par le GATC.
Les participants à l’atelier ont convenu de la nécessité de combler les lacunes systémiques identifiées dans le rapport et de travailler ensemble à l’élaboration d’un meilleur système de suivi, en s’appuyant sur des données provenant de sources multiples, y compris les Peuples Autochtones et les communautés locales. Actuellement, les rapports sont basés sur des estimations, des méthodologies ad hoc et des enquêtes, qui sont complexes et prennent du temps, et comportent des risques importants d’erreurs de calcul, d’interprétation et de double comptage, selon le rapport publié aujourd’hui. L’objectif sera d’élaborer un plan pour remédier à l’absence de réponses à des questions fondamentales telles que : combien d’argent est affecté aux Peuples Autochtones et aux communautés locales, dans quel but et avec quel impact.


Shandia mène un dialogue politique et de haut niveau pour faciliter le financement des peuples autochtones et des communautés locales.
En faisant état des difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir des financements directs pour leurs communautés, les membres du GATC ont déclaré qu’ils étaient reconnaissants envers les ONG partenaires dont la mission s’aligne étroitement sur la leur et qui reçoivent des fonds destinés à soutenir les Peuples Autochtones et les communautés locales.
“Il ne s’agit pas d’un argument pour retirer des fonds à nos partenaires et alliés les plus proches”, note le rapport du GATC, “mais cela souligne le besoin immédiat d’augmenter le financement de nos organisations afin de créer des conditions de concurrence équitables”.
Les efforts de collecte de données pour le rapport du GATC ont révélé que les Peuples Autochtones et les communautés locales restent souvent exclus des discussions sur le financement de leurs propres territoires et organisations. Les systèmes mondiaux de notification de l’aide au développement mis en place par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) n’ont pas non plus permis de suivre l’évolution du financement des Peuples Autochtones et des communautés locales.
“Il est urgent d’inverser la tendance, mais les progrès sont terriblement lents”, a déclaré Lord Goldsmith, qui était ministre des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement au sein du gouvernement britannique lorsqu’il s’est joint à d’autres donateurs de premier plan pour prendre cet engagement à Glasgow. “L’argent semble souvent s’évaporer dans des transactions complexes à travers de nombreux niveaux d’institutions multilatérales, ce qui fait craindre que trop peu de choses soient faites pour soutenir la quête des Peuples Autochtones et des communautés locales pour leurs droits fonciers en tant que solution au problème du climat”.

Face à cette situation, les dirigeants d’organisations représentant des milliers de Peuples Autochtones et de communautés locales du monde entier ont créé des fonds et d’autres mécanismes permettant d’acheminer directement les fonds vers les communautés.
Selon le rapport du GATC, ces fonds soutiennent les activités des communautés, tout en aidant à renforcer les capacités techniques et à développer des indicateurs et des priorités qui conviennent aux communautés et les aident à mesurer et à rendre compte de l’impact. “Leur conception repose sur des consultations approfondies afin de s’aligner sur les priorités et les plans des communautés et de répondre rapidement aux urgences et à l’évolution des situations sur le terrain”, écrivent les auteurs.

Afin d’encourager une plus grande transparence sur la destination des fonds, le GATC a créé la plateforme Shandia pour soutenir les fonds gérés par les autochtones et les communautés, pour plaider en faveur d’un financement plus direct, efficace et durable, et pour assurer un suivi précis des fonds.
“Le besoin d’un véhicule qui puisse nous aider à interagir avec les bailleurs de fonds reste une question cruciale pour notre objectif d’investissement direct territorial”, a déclaré Sucre Romero. “C’est pourquoi nous avons proposé la plateforme Shandia et créé plusieurs mécanismes de financement au niveau national et régional afin de faciliter le financement direct de nos territoires et de nos communautés pour des actions de lutte contre le changement climatique, de conservation de la biodiversité et de maintien de nos droits. Sans cela, nous n’aurons pas la possibilité d’être aux commandes de la conception de solutions climatiques efficaces ; nous ne pourrons pas influencer ce que ces donateurs financent et où.”